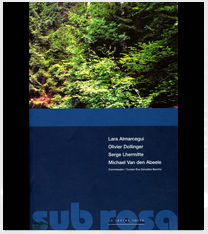
Serge Lhermitte : Je ne pense pas que le monde du travail et la sphère privée sont si étanches que l'on veut bien le faire croire. En tout les cas, pas pour toutes les couches sociales, et certainement pas avec les gens que j'ai pu côtoyer et qui ont accepté de jouer le jeu avec moi. Possédant ce que j'appelle un emploi à faible valeur ajoutée
, ne gagnant pas des salaires élevés, ils ont articulé leur vie autour de l'acquisition d'un bien immobilier (du petit pavillon au 2 pièces) pour y vivre une certaine idée du bonheur. Jusque-là, rien de bien nouveau, sauf que l'arrivée des 35 heures leur a vraiment fait peur. Ils ont vu, à cause du coup de frein donné aux heures supplémentaires, arriver une perte sèche sur leurs bulletins de salaires. Les extras, les vacances, les cadeaux se sont diminués d'autant que la plus grosse partie du salaire part dans le crédit. Beaucoup, et là je pense surtout à Eric, ont dû trouver un emploi d'appoint pour compenser cette perte. Le domicile qui était jusque-là effectivement préservé de la vision du travail, s'est alors retrouvé spectateur ou zone tampon entre les deux emplois. C'est cela que j'ai voulu mettre en forme : un domicile, une vie familiale spectatrice d'une vie salariale.
Je ne voulais pas une forme distanciée, critique ou trop analytique ; j'ai eu la chance que ces gens m'ouvrent leurs portes et leurs vies, et j'en ai profité pour m'immiscer dans leur univers. Une photographie de type journalistique aurait été justement trop distanciée, trop froide. Une série aurait posé les même problèmes, avec une idée de bavardage en plus. Je pense que c'est justement le champ artistique qui peut palier à ces problèmes : le carcan des codifications y est moins contraignant, et l'on peut évacuer la lourdeur du médium photographique, au profit de la malléabilité de l'image
. Du moins c'est comme cela que je vois les choses ! Travailler l'image comme un tableau, ce qui est le cas dans cette série, de façon froide et objective à la manière des Becher, ou comme un visuel de communication, toutes ces formes nous sont permises.
compositesemployés par les mannequins ou les acteurs pour communiquer auprès de leurs employeurs potentiels.
S.L. : Oui, comme un moyen de communication plus que de promotion... bien que... Quand j'ai lancé le projet, je n'avais pas vraiment d'idée préconçue quant à la mise en forme du résultat. Dans La vie de château, je peux mettre huit à dix mois avant d'aboutir à une image. Un temps qui est nécessaire pour construire un rapport de confiance, et d'intimité. Le mois et demi passé en résidence ne permet pas les même relations, d'autant qu'il ne s'agissait pas de personnes du quotidien mais de personnalités publiques. Mais plus qu'une question de temps, de confiance ou d'intimité ce sont surtout les enjeux qui sont différents. C'est effectivement toujours une réflexion autour du travail et du temps libre, mais pris d'un point de vue diamétralement opposé. Dans la série "La vie de château", le travail, qui n'existe que sous la forme d'un emploi, ne sert qu'à construire un temps libre articulé autour de la sphère privée. A l'inverse, dans la série "Maire(s)", le temps libre est utilisé comme un temps de travail au même titre que le temps de l'emploi. Le temps libéré, pour utiliser une autre terminologie, n'est pas consommé uniquement dans la sphère privée, il sert cette fois-ci à développer l'environnement pour soi et sa famille certes, mais surtout et aussi pour les autres. Ce temps libéré n'a pas la même fonction dans les deux cas. Les modes de vie sont différents lorsque l'on est coiffeuse et que le reste du temps on s'occupe de ses deux enfants ou lorsque l'on est responsable d'une chaîne de production et maire d'une petite commune rurale. Présenter ces deux façons de concevoir le rapport emploi/temps libéré de la même manière me paraissait impossible.
Si l'idée de la forme tableau (ou photographie de famille) me semblait appropriée pour ceux qui axent leur temps libre vers l'intérieur de la cellule familiale, le visuel de communication m'a paru la meilleur forme pour ceux tournés vers l'extérieur. Et puis je dois avouer que composer les images de la vie de chacun des maires à la manière des visuels de communication du théâtre de la ville m'amusait beaucoup, juste un petit clin d'oil à la société du spectacle
de Debord.
S.L. : J'espère qu'ils le sont tous ; en tout cas c'est comme cela qu'ils sont construits.
Dans la vie, la vraie
- excuse-moi pour le slogan mais il m'amuse -, comme beaucoup d'entre nous j'ai une activité de salarié. Je passe une partie de mon temps au sein d'une entreprise, j'y subis ses contraintes de rentabilité, ses impératifs de transformations suite à un rachat, je fais partie intégrante du corps social. C'est un élément auquel je tiens, j'ai besoin de sentir ce corps social pour le travailler. Alors bien évidemment, parfois je ne peux pas avoir tout le détachement qui pourrait être souhaitable, et j'ai envie de pousser un coup de gueule
. C'est le principe de ce que je nomme (peut-être à tort) mes actions
, dont fait partie A qui profite le vide ? Dans l'entreprise à laquelle j'appartiens on parle de tout, rarement du travail, et les thèmes de sociologie ou de politique s'arrêtent là où le journal de 20 heures s'est arrêté. La prise de conscience de la citoyenneté pour la plupart d'entre nous se fait entre 20h et 20h30 - avant ou après, la citoyenneté c'est ce qui reste après avoir tout oublié
. Alors évidemment lorsque les médias et les politiques ne font pas ce travail de rappel à la conscience citoyenne, l'administré reste au sens étymologique du terme une personne soumise
, en d'autres termes un acteur passif.
C'est ce qui m'a énervé dans ces européennes de 1999 : que nos élus ou nos politiques nous prennent pour de simples administrés passifs, et qu'ils fassent passer leurs volontés grâce à la désaffection des urnes. "A qui profite le vide ?" est un coup de gueule, un cri à la face des politiques (les panneaux électoraux), à destination des administrés que nous sommes, sur la place publique. Bien évidemment cela ne change rien, on a vu les résultats, mais ça fait du bien !
S.L. : C'est ce que j'appelle, non sans ironie, la gestion de ma schizophrénie
. Mais pour parler plus sérieusement je pense vraiment que cette formule a du sens. Je ne vois pas ce que pourrait m'apporter le fait de vivre dans un mythe une partie du temps, et dans une réalité de survie une autre partie. Il me semble que d'ailleurs on ne peut que subir un mythe. Par contre, gérer
ces deux univers pour qu'ils puissent s'alimenter l'un et l'autre est une position qui m'intéresse. Le réalisme dont tu parles est lié à cette imbrication : les personnes qui sont sur mes photos ne sont pas des modèles, ils sont leur propre représentation, qu'il s'agisse de non-cadres ou d'ingénieurs informaticiens (comme pour l'affiche qui m'a servi pour les images de T'aime encore ?). Alors évidemment si je joue l'individualiste, si je m'enferme dans le microcosme artistique, comment pourrais je prétendre représenter une certaine réalité sociologique ? Ce sont les discussions, dont je t'ai parlé, et les commentaires qu'ils font tout au long du projet qui alimentent et rectifient l'idée de la forme que je pourrais avoir au départ. Ils savent que je fais de l'art
mais ils veulent comprendre, se comprendre, et c'est sûrement pour cela que le réalisme semble indispensable.
S.L. : Effectivement, les deux séries "A qui profite le vide ?" et "T'aime encore ?" fonctionnent de la même façon. Elles sont le résultat d'une action, pas vraiment au sens artistique du terme, mais comme pourrait les mener un militant de parti politique, ou un site 3615 Q qui ferait de façon sauvage sa promotion. Les affiches sont bien sûr réalisées en fonction de ce qu'elles traitent. L'affiche d'"A qui profite le vide ?" n'est pas un photomontage, mais simplement un cliché qui par son angle de prise de vue juxtapose trois plans différents, ce qui donne l'impression effectivement d'un trucage. Mais je suis d'accord avec l'idée qu'elle renvoie à la radicalité des photomontages des années 30. Car il s'agissait comme je te l'ai dit tout à l'heure d'un coup de gueule et comme tout coup de gueule, il se veut radical.
Les affiches, collées directement sur d'anciens bâtiments industriels, qui servent pour "T'aime encore ?", présentent un jeune cadre antillais perdu dans un univers de sièges sociaux à La Défense. Elles s'opposent - ou, comme tu le dis, rentrent en collision - avec l'image nostalgique, presque romantique, que l'on pourrait avoir de ces bâtiments. Placer cette affiche sur ces bâtiments permet de confronter dans un même espace-temps deux visions d'un même monde industriel, séparées par deux guerres et deux révolutions. Le fait de photographier les bâtiments avec ce que tu appelles une volonté descriptive, mais que je préférerais appeler une volonté contextuelle, permet de remettre à leur place ces anciens joyaux d'une économie industrielle dépassée.
S.L. : Il existe en fait deux séries distinctes pour "Itinéraire d'un tourisme intéressé", l'une construite par la manipulation informatique - ce sont les images tirées en 4 mètres par 3 -, et une autre sous-titrée Portrait(s) qui est construite effectivement sans manipulation. Toutes deux ont été construites en fonction de ce que je voulais leur faire dire. La série dont tu parles part d'un précepte simple : un quartier entier de Cherbourg doit être entièrement restructuré dans un délai assez court. A partir de cette réalité, je me suis imposé un petit exercice photographique. En reprenant l'idée simple (ou simpliste) de la photographie comme moyen d'enregistrement d'un instant fugitif, je me suis demandé qui, des humains et leurs attitudes où de l'urbanisme et son architecture, à l'instant ou je prenais mon cliché, était le plus éphémère. Dans les décennies à venir, il est certain que les habitants continueront à aller et venir de leur logement au centre ville, aux commerces ou à leur travail, à pied ou en vélo ; par contre, la zone qu'ils traverseront sera immanquablement métamorphosée. Certains bâtiments seront détruits, certains axes transformés. Alors que les habitants resteront, les bâtiments disparaîtront. La proposition habituelle de la photographie - l'humain étant le phénomène à enregistrer, l'éphémère, et l'architecture son environnement contextuel -, est ici inversée. L'architecture est l'éphémère et l'humain le contextuel . C'est pourquoi le Portrait(s) n'est pas celui auquel on pense, il ne s'agit pas de l'humain qui traverse la photographie, flou, indistinct, il s'agit de celui de l'architecture de cette zone. Portrait d'un quartier plus que portrait des gens du quartier.
L'autre série par contre est complètement manipulée par informatique, non pas pour faire une image irréelle, mais pour recontextualiser et exacerber un phénomène. Cherbourg, comme toutes ces villes tournées vers la Manche, possède ses cars-ferrys et son lot de touristes anglais qui débarquent pour la journée afin de faire leur plein d'alcool et de cigarettes et qui repartent le soir. Pour le spectateur que j'étais, la vision de ces touristes, chargés de sacs et poussant des caddies remplis de cartons de vin et de bière, traversant la ville de la grande surface au débarcadère, m'a paru ahurissante. Pour deux raisons : d'une part, d'un point de vue politique avec la vision que cela peut nous donner de l'Europe (un espèce de gros supermarché transnational), et d'un point de vue sociologique, d'autre part, avec des gens étrangers (dans tout les sens du terme) les uns pour les autres, qui se croisent sans se voir, et qui tirent profit de cette situation. J'ai donc voulu rassembler, dans une même image, la contrainte géographique que j'avais (de cette zone dont je t'ai parlé pour la série des Portrait(s)), et les deux attitudes humaines, celle du touriste intéressé
et celle de l'autochtone indifférent (bien que profitant). Tout ces éléments étant remontés
, grâce à l'outil informatique, avec ce que tu appelles une exigence de réalisme . Ces cinq images qui, techniquement, ne montrent pas le photomontage, mais qui, esthétiquement, le découvrent - les cherbourgeois étant flous (attitude habituelle, banale, indéfinie), et les trippers
étant nets (attitude particulière symptomatique d'un phénomène), étaient initialement destinées à retourner dans l'espace public sur des panneaux publicitaires. Ces images travaillées comme des publicités et présentées comme telles n'auraient rien promu : ni le tourisme, ni la grande surface, ni les compagnies de car-ferry, ni la ville de Cherbourg, ni l'Europe. Elles auraient peut être essayé de montrer à tous que certains phénomènes ne sont que la résultante de décisions politiques locales ou européennes, combinées à des infrastructures économiques. Ces images ne sont malheureusement pas sorties dans l'espace public, et ont été montrées dans un lieu destiné à consacrer de l'art ! Surtout, que chacun reste à sa place !
S.L. : En 97-98, je redécouvre une notion que j'avais oubliée : la surmodernité en anthropologie. Je dis redécouvrir parce que cette notion était depuis un certain temps déjà un principe de base, voire un leitmotiv pour l'imagerie contemporaine. J'ai eu envie alors de savoir comment les politiques et les urbanistes des années 60 avaient pu imaginer les hommes modernes (ou surmodernes), c'est à dire-nous. J'avais donc envie de travailler sur des réalisations globales, pas seulement sur des zones périurbaines où la mixité des parties modernes et historiques, on le sait, a du mal à se faire, mais justement là où ont été pensées et réalisées, avec une volonté d'harmonie d'ensemble dans un grand élan de surmodernité, les villes nouvelles. Je me suis donc abondamment promené dans ces villes autour de Paris mais aussi autour de Londres, et y ai trouvé des similitudes étranges. La plus symptomatique, et dont j'ai essayé, dans cette série "Lundi c'est caddie", de garder la trace, est celle que j'ai pu trouver à Milton Keynes et à Evry. Ces deux villes, d'un point de vue urbanistique, ont été axées, littéralement, sur la société de consommation. En les construisant autour d'un énorme centre commercial, qui fait office de centre ville, les pouvoirs publics ont dû penser que le lien social se ferait naturellement (par l'achat). Que l'acte de consommer remplacerait le manque d'âme et d'histoire de ces jeunes villes. Le fait est qu'effectivement la vie de la ville, ses rythmes, son activité, peuvent se lire grâce à un seul objet, à ce symbole de la consommation de masse qu'est le caddie. Le vendredi ou le samedi, les habitants font les courses au gigantesque supermarché, reviennent chez eux, en passant par toute l'infrastructure urbaine qui permet au piéton de ne jamais rencontrer l'automobile, puis laissent le chariot en bas de leur immeuble. Le samedi et le dimanche, jeunes ou moins jeunes utilisent ces pauvres contenants vides de sens pour en faire ce que bon leur semble. Le lundi, un employé est chargé de les ramener à destination, pour que de nouveau le samedi. etc. Résultat, si on se donne la peine de regarder tous les lundis dans ces villes, avant le préposé aux caddies, on peut y retrouver toutes les activités du week-end. On peut y mesurer ses tensions voire ses violences. C'est pour cela que ces images sont dénuées de présence humaine parce que le caddie est ce que tu appelles un portrait en creux
des habitants, et que montrer les deux me semblerait redondant.
Quant à leur sérialisation, cela m'est apparu comme la seule forme possible, car il ne s'agit pas d'un moment particulier, dans une situation particulière - c'est peut être un épiphénomène mais à l'échelle d'une ville. Ces situations se répètent durant trois jours sur sept, et chaque semaine. Je serais tenté de dire chaque semaine depuis que ces villes ont été créées. Elles ne sont pas localisées à un endroit particulier de la ville, on les retrouve partout. Montrer une seule image, la spectaculariser, n'aurait rien donné pour la perception de l'ampleur du phénomène. A l'inverse, remplir un mur de ces images qui, décontextualisées, pourraient sembler anodines, ramène une ambiance, un contexte. Par la série, ces portraits en creux
, discourent entre eux, présentent leurs tensions mais tous à leur manière en fonction de leur âge et de leur statut. Peut-être ai-je réussi là où les politiques et les urbanistes ont échoué : recréer un lien social grâce à un objet de commerce !